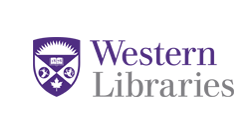Écologie poétique-critique de l'économie de la connaissance ou comment inventer une ethnographie littéraire contre-éducative
Abstract
Ce travail cherche à circonscrire le problème de la force que pose un acte d’écriture qui se saisirait sous la forme d’un geste. Le biais spécifique des études littéraires est de désincorporer la relation entre une œuvre et sa situation. Ce biais a la fâcheuse tendance de désamorcer le contexte d’action et, par voie de conséquence de le rendre insaisissable. Pour examiner la formation du geste verbal, des échantillons tirés des oeuvres de Jean-Marie Gleize et de Charles Olson, les pictographes Ojibwe et les travaux en contre-éducation des sociologues Stein et Miller nous aideront à reconstituer les conditions de possibilité du geste.
Dès lors que l’on constate que les gestes résonnent et s’articulent dans l’environnement social et institutionnel qui les a vu naître, il devient nécessaire d’enregistrer et d’analyser les mouvements mêmes de l’environnement. En testant l’amplitude du geste verbal, il n’est pas impossible d’appliquer et d’entraîner un mode de perception directe des actions qui sans cela resterait enfermé, selon le mode interprétatif littéraire usuel, dans une bibliothèque mentale. Radicale, pour ne pas dire orpheline, la critique pratique d’I.A. Richards est mobilisée et révisée au contact de la psychologie écologique de J.J. Gibson. Le démontage de la position réceptionniste de Fish sert de première étape vers une pratique interactionniste du geste verbal à la base d’une critique littéraire qui serait proprement écologique. Cet instrument écologique d’analyse s’inscrit en même temps dans un développement plus large qui est emprunté à la théorie de la communication canadienne (Innis, Frye, McLuhan, Grant) pour essayer d’ancrer une double question : comment arriver à être ici et maintenant ?
La compression de l’espace-temps universitaire – à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe – et la spécialisation des ressources attentionnelles contraignent les agents dans la mise en scène de leurs rituels de mise en commun. La dernière étape de la recherche consiste à enregistrer et à comparer les modalités d’interaction de deux groupes : un groupe de littéraires d’un côté, et un groupe de médecins spécialisés en médecine narrative de l’autre. Les déclencheurs de contexte singuliers que sont Denis Roche, le modèle de photos érotiques Margot et Williams Carlos Williams permettent d’extraire les incapacités entraînées des groupes et d’observer des éléments appartenant à la matrice du conditionnement mythologique que renforce l’université néolibérale.