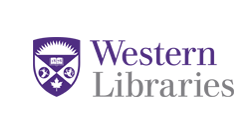La réalisation acoustique des mots grammaticaux dans la parole spontanée du français européen
Abstract
Les clitiques sont des unités prosodiquement déficientes qui ont fait couler beaucoup d’encre parmi les syntacticiens, les morphologistes et les phonologues. La langue française distingue les clitiques en position proclitique et enclitique. Les proclitiques sont des mots grammaticaux qui s’attachent à gauche du mot hôte, qui est dans la plupart des cas un mot lexical, tandis que les enclitiques s’attachent à droite des mots lexicaux en terminant le groupe accentuel. Les enclitiques sont capables de recevoir un accent de groupe. Dans les positions accentuées, les enclitiques sont marqués par la montée de fréquence fondamentale et l’allongement vocalique. En revanche, les mots grammaticaux en position proclitique ne peuvent en recevoir. Néanmoins, la question du privilège de recevoir un accent par les mots grammaticaux même en position proclitique reste ouverte. Plusieurs phonéticiens affirment, pourtant sans aucun support empirique, nous parait-il, que le comportement prosodique des mots grammaticaux est fort sous-estimé et que certaines catégories de la classe de mots, dites atones, peuvent recevoir l’accent même en position proclitique.
Les questions que nous nous posons dans notre étude doctorale sont comment les mots grammaticaux se comportent prosodiquement dans la parole spontanée. Sont-ils toujours atones ? Les propriétés acoustiques des mots clitiques diffèrent-elles des propriétés des syllabes faibles des mots lexicaux ? Quels sont les facteurs linguistiques et/ou externes qui pourraient déclencher l’accentuation sur les mots grammaticaux ? S’agit-il de l’accentuation ou d’un autre phénomène tout à fait différent ? Le système accentuel du français peut-il générer différents types d’accent ?
Notre thèse doctorale cherche à répondre à toutes ces questions. Pour le faire, nous entreprenons une analyse comparative des valeurs normalisées en cote-z de durée et de fréquence fondamentale des noyaux vocaliques des mots grammaticaux monosyllabiques et polysyllabiques en les comparant avec ceux des mots lexicaux en positions initiale, finale et à l’intérieur des mots. Notre base de données est présentée par un échantillon de trente locuteurs natifs (quinze hommes et quinze femmes) de trois variétés du français européen (France, Belgique et Suisse). Toutes les données sont aussi réparties selon le style de parole, c’est-à-dire [+formel] et [–formel]. Nous réalisons plus d’une vingtaine de tests de normalisation et plus d’une dizaine de tests statistiques pour évaluer le comportement acoustique des mots grammaticaux dans différents contextes situationnels (discours politiques et récits de vie).